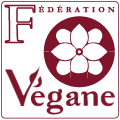Spécisme, antispécisme et carnisme !
Cette terminologie abondante est souvent invoquée dans les discussions sur les animaux, mais que veut-elle dire ? Les débats passionnés permettent rarement de se faire une idée précise sur le sujet. Nous proposons donc un retour aux sources d’un point de vue végane.
Le terme véganisme date de 1944. Il s’agit de « vivre sans exploiter les animaux » [1]. Cet idéal est devenu une réalité grâce à la découverte de l’origine bactérienne de la vitamine B12 et à la maîtrise de ses techniques de culture. Cette consomm’action permet notamment de tuer moins d’organismes vivants parmi l’ensemble des règnes.
 Le terme spécisme a été inventé en 1970, par une personne qui n’a jamais été végane [2]. Richard Ryder a prétendu que les animaux subissaient des expériences douloureuses en raison d’une discrimination dont le critère est leur appartenance à une espèce différente [3]. C’est malheureusement faux, car des expériences douloureuses sur l’espèce humaine ont également été réalisées dans l’histoire [4]. L’idée a pourtant été reprise : alors qu’il n’était pas même végétarien [5], Peter Singer a publié un livre intitulé Libération animale en 1975, pour diffuser la notion d’antispécisme.
Le terme spécisme a été inventé en 1970, par une personne qui n’a jamais été végane [2]. Richard Ryder a prétendu que les animaux subissaient des expériences douloureuses en raison d’une discrimination dont le critère est leur appartenance à une espèce différente [3]. C’est malheureusement faux, car des expériences douloureuses sur l’espèce humaine ont également été réalisées dans l’histoire [4]. L’idée a pourtant été reprise : alors qu’il n’était pas même végétarien [5], Peter Singer a publié un livre intitulé Libération animale en 1975, pour diffuser la notion d’antispécisme.
En tant qu’espèce animale, il nous est impossible de vivre sans consommer des organismes qui appartiennent à d’autres espèces [6]. L’antispécisme ne peut donc pas exister, pas au sens littéral. Les auteurs animalistes ayant appuyé leurs travaux sur l’antispécisme ont donc proposé d’épargner les organismes capables d’éprouver de la souffrance [7]. Cela présente plusieurs problèmes :
- Trier l’ensemble des organismes en fonction de leur ressemblance à l’espèce humaine (capacité à éprouver de la souffrance) recrée une hiérarchie arbitrairement anthropocentrée.
- Ce système de discrimination décrète que les plantes et tous les organismes qui ne sont pas capables d’éprouver de la souffrance n’ont aucun intérêt à vivre [8].
- Pour faire le tri parmi l’ensemble des organismes vivants, il est nécessaire de conduire des expériences permettant de déterminer lesquels souffrent ou non, or conduire des expériences sur des organismes potentiellement capables d’éprouver de la souffrance n’est pas cohérent avec leur protection.
- Cela ne mènera théoriquement pas au véganisme, car la capacité à souffrir des organismes vivants exclura 99 % des espèces animales (principalement constituées d’invertébrés, chez lesquels il est très rarement possible de démontrer la souffrance) [9].
À l’image de l’inventeur du mot spécisme, des personnes qui se présentent comme antispécistes peuvent consommer des produits d’origine animale tels que les produits laitiers, les œufs, le miel, les moules ou les huîtres, et n’hésitent pas à invoquer l’expérimentation animale pour défendre les animaux, ce qui paraît contradictoire. Le spécisme et l’antispécisme sont des concepts dont le berceau n’était pas le véganisme.
L’existence même du spécisme est discutable, car si l’humanité consomme des produits d’origine animale depuis ses origines, c’est tout d’abord pour satisfaire un besoin en nutriment essentiel. Les produits d’origine animale constituaient l’unique source de vitamine B12 depuis des millions d’années. Les sources de vitamine B12 telles que les limaces et escargots, les vers et larves, ou les insectes et coquillages ont vraisemblablement précédé les grands animaux auxquels l’invention de la chasse puis de l’élevage ont donné accès [10]. La culture bactérienne de ce nutriment qui nous permet désormais de nous affranchir de l’élevage n’a été découverte que très récemment, le 12 décembre 1947 [11].
 Qu’est-ce qu’une discrimination spéciste ? C’est une discrimination qui serait fondée sur l’infertilité des organismes entre eux (une espèce est un groupe interfécond). Mais une discrimination d’après ce critère suppose la connaissance de la notion d’espèce, qui est pourtant très tardive dans l’histoire de l’humanité [12]. Nos ancêtres ont surtout mangé des animaux par besoin. En plus d’être une erreur nutritionnelle, considérer que nos ancêtres les plus lointains ont mangé les animaux pour la seule raison qu’il leur était impossible de se reproduire avec eux est anachronique. La pratique du cannibalisme chez nos ancêtres contredit également l’antispécisme [13], car l’espèce humaine figurait elle aussi au menu… L’abandon progressif des sacrifices humains, de l’anthropophagie et la reconnaissance des droits fondamentaux vers lesquels l’humanisme nous a menés ne devraient pas être considérés comme une discrimination envers les autres organismes, mais comme un progrès d’intérêt général à poursuivre.
Qu’est-ce qu’une discrimination spéciste ? C’est une discrimination qui serait fondée sur l’infertilité des organismes entre eux (une espèce est un groupe interfécond). Mais une discrimination d’après ce critère suppose la connaissance de la notion d’espèce, qui est pourtant très tardive dans l’histoire de l’humanité [12]. Nos ancêtres ont surtout mangé des animaux par besoin. En plus d’être une erreur nutritionnelle, considérer que nos ancêtres les plus lointains ont mangé les animaux pour la seule raison qu’il leur était impossible de se reproduire avec eux est anachronique. La pratique du cannibalisme chez nos ancêtres contredit également l’antispécisme [13], car l’espèce humaine figurait elle aussi au menu… L’abandon progressif des sacrifices humains, de l’anthropophagie et la reconnaissance des droits fondamentaux vers lesquels l’humanisme nous a menés ne devraient pas être considérés comme une discrimination envers les autres organismes, mais comme un progrès d’intérêt général à poursuivre.
 La méthode que la propagande antispéciste utilise le plus souvent pour convaincre insiste sur les différences de traitement selon l’espèce. Le soin apporté à un animal dit « de compagnie » est opposé au sort de ceux qui sont élevés pour être mangés. La perspective d’être mangé n’est en rien réjouissante, certes, mais la réalité n’est pas si simple, car aucune de ces exploitations n’est enviable. Il est particulièrement maladroit de suggérer que les animaux utilisés pour la compagnie sont choyés : ils naissent dans la servitude, au terme d’une reproduction dirigée qui, menée depuis des millénaires, appauvrit leur génome, et mènent dans le meilleur des cas une existence faite d’ennui lorsqu’ils ne sont pas maltraités, abandonnés par dizaines de milliers chaque année sur la route des vacances, obligés de courir ou de combattre, ou tués par des balles perdues à la chasse. En d’autres termes, les soins prodigués aux braves chiens de canapé doivent être pondérés par les souffrances que la domestication inflige à leurs congénères et par la dégradation de leur génome de loup (tous les chiens proviennent du loup gris).
La méthode que la propagande antispéciste utilise le plus souvent pour convaincre insiste sur les différences de traitement selon l’espèce. Le soin apporté à un animal dit « de compagnie » est opposé au sort de ceux qui sont élevés pour être mangés. La perspective d’être mangé n’est en rien réjouissante, certes, mais la réalité n’est pas si simple, car aucune de ces exploitations n’est enviable. Il est particulièrement maladroit de suggérer que les animaux utilisés pour la compagnie sont choyés : ils naissent dans la servitude, au terme d’une reproduction dirigée qui, menée depuis des millénaires, appauvrit leur génome, et mènent dans le meilleur des cas une existence faite d’ennui lorsqu’ils ne sont pas maltraités, abandonnés par dizaines de milliers chaque année sur la route des vacances, obligés de courir ou de combattre, ou tués par des balles perdues à la chasse. En d’autres termes, les soins prodigués aux braves chiens de canapé doivent être pondérés par les souffrances que la domestication inflige à leurs congénères et par la dégradation de leur génome de loup (tous les chiens proviennent du loup gris).
 Le terme spéciste fédère certains animalistes, parce qu’il leur semble désigner « l’ennemi » [14]. Depuis 2001, il est concurrencé par le terme carniste [15]. Les personnes dont l’alimentation est conventionnelle n’ont pas choisi les termes par lesquels elles sont désignées. On appelle ces mots des exonymes (« noms que les autres donnent à soi »). Cultivant l’analogie avec les termes raciste et sexiste, cet activisme sert à condamner « l’autre » moralement, mais pour une discrimination dont personne ne s’est rendu coupable, puisque la consommation de produits d’origine animale est une condition nutritionnelle héritée. Le racisme n’a jamais été une nécessité, pas plus que le sexisme. Au-delà des amalgames, le public ne s’identifie pas aux revendications exagérées [16].
Le terme spéciste fédère certains animalistes, parce qu’il leur semble désigner « l’ennemi » [14]. Depuis 2001, il est concurrencé par le terme carniste [15]. Les personnes dont l’alimentation est conventionnelle n’ont pas choisi les termes par lesquels elles sont désignées. On appelle ces mots des exonymes (« noms que les autres donnent à soi »). Cultivant l’analogie avec les termes raciste et sexiste, cet activisme sert à condamner « l’autre » moralement, mais pour une discrimination dont personne ne s’est rendu coupable, puisque la consommation de produits d’origine animale est une condition nutritionnelle héritée. Le racisme n’a jamais été une nécessité, pas plus que le sexisme. Au-delà des amalgames, le public ne s’identifie pas aux revendications exagérées [16].
Le véganisme, plus ancien et plus pragmatique, repose sur un progrès technique : la culture bactérienne de la vitamine B12. Bien que l’abstinence de tout produit d’origine animale reste la meilleure garantie de ne plus participer aux souffrances potentiellement infligées aux animaux, vivre sans les exploiter permet également de tuer moins d’organismes parmi l’ensemble des règnes. Ce mouvement pacifique ne rompt pas avec l’humanisme. Il se traduit simplement par une consomm’action qui, en modifiant la demande, conduit les entreprises à s’adapter pour effectuer leurs transitions, elles aussi. La Société végane francophone accompagne et sécurise ce changement avec bienveillance, en informant le plus précisément possible, sans autre ennemi que l’ignorance.

—————
NOTES
1. Donald Watson explique comment le terme vegan a été formé (par contraction du mot vegetarian) dans le premier numéro du périodique intitulé The Vegan News, fin 1944. Le terme ne reçoit de définition officielle qu’en 1950 (après la découverte de la vitamine B12), à l’occasion du vote de la nouvelle constitution de la Vegan Society (association fondée par Donald Watson).
L’annonce de cette définition officielle a été faite dans l’édition de printemps 1951 de The Vegan (pages 2 et 3). Les raisons du succès mondial du terme végane sont expliquées en détail par Jasmine Perez dans la vidéo intitulée « Conséquences lexicales de la découverte de la vitamine B12 » (passez au mode grand écran et faites apparaître les sous-titres, car la prise de son n’était pas professionnelle).
2. Demande d’interview du 24 janvier 2015 pour le magazine Végane :
Constantin Imbs – « Cher Richard, la Société végane francophone serait honorée de pouvoir vous interviewer au sujet de la vie dédiée aux animaux que vous avez menée. Merci par avance pour la considération bienveillante que vous porterez à cette requête. »
Richard Ryder – « Merci. Je suis honoré. Vous savez, en réalité, je ne suis pas végane. Je suis végétarien, mais j’ai trouvé que le véganisme était trop difficile. Je suis un militant antispéciste qui a essayé de mener des changements politiques concrets, basés sur des arguments moraux solides. J’admire les véganes et j’aimerais en être un. Je le devrais. Mais je trouve que nous ne devrions pas exclure du mouvement politique ceux qui, comme moi, sont trop vieux ou trop stupides pour être véganes, mais qui peuvent aider les animaux non humains. La douleur, dans tous les sens du terme, est l’ennemie. Vive le dolorisme ! Vive le véganisme ! » (traduit depuis l’anglais, voir ci-dessous)
Constantin Imbs – « Dear Richard, The French Vegan Society would be very honoured to make an interview about your life of dedication to the animals. Very many thanks in advance for your kind consideration. »
Richard Ryder – « Thank you. I am honoured. You know I am not actually a vegan. I am vegetarian but have found veganism too difficult. I am an anti speciesism campaigner who has tried to achieve solid political changes, based on sound moral argument.i admire vegans and wish I was one. I should be. But I feel we must not exclude from the political movement those, like me, who are too old or stupid to be vegans but who can still be of help to the nonhuman animals. Pain, in its widest sense, is the enemy. Vive Painism ! Vive veganism ! »
(échange d’e-mails de janvier 2015 entre Richard Ryder et Constantin Imbs)
3. Traduction du pamphlet original que Richard Ryder a fait circuler à Oxford en 1970 :
« Spécisme
Depuis Darwin, le consensus scientifique est qu’il n’existe pas de différence fondamentale de nature “magique” entre les humains et les autres animaux, pas sur le plan biologique. Pourquoi donc faisons-nous une distinction morale presque totale ? Si tous les organismes sont sur un seul continuum physique, nous devrions logiquement nous placer sur ce même continuum moral.
Le terme espèce, tout comme le terme race, n’est pas précisément définissable. Les lions et les tigres peuvent se reproduire entre eux. Dans des conditions de laboratoire, il pourrait être bientôt possible d’accoupler gorille et professeur de biologie – leur rejeton poilu sera-t-il mis dans une cage ou un berceau ?
Il est habituel de considérer les néandertaliens comme une espèce différente de la nôtre, une espèce particulièrement apte à la survie dans les conditions de l’âge de glace. Pourtant, la plupart des archéologues pensent que cette créature non humaine pratiquait des inhumations rituelles et qu’elle possédait un cerveau plus grand que le nôtre. Supposons que la capture de l’abominable homme des neiges furtif révèle qu’il s’agit du dernier survivant de l’espèce néandertalienne, lui donnerions-nous un siège à l’ONU ou implanterions-nous des électrodes dans son super cerveau ?
J’utilise ces hypothétiques mais possibles exemples pour attirer l’attention sur l’illogisme de notre position morale actuelle au sujet des expériences sur les animaux.
Environ 5 000 000 d’animaux de laboratoire, comptant de plus en plus de primates tels que nous, sont tués chaque année rien qu’au Royaume-Uni ; l’augmentation de ce chiffre est actuellement hors de contrôle. Il n’y a que 12 inspecteurs du ministère de l’Intérieur.
Très différent du droit à vivre, la souffrance est un critère moral clair, la souffrance de l’emprisonnement, de la peur, de l’ennui, ainsi que de la douleur physique.
Si nous nous considérons que la souffrance est une fonction du système nerveux, il est illogique de prétendre que les autres animaux ne souffrent pas d’une façon semblable à la nôtre – c’est d’ailleurs précisément parce que certains animaux ont des systèmes nerveux ressemblant étroitement au nôtre qu’ils sont tant étudiés.
Les seuls arguments en faveur de l’expérimentation animale douloureuse sont : 1) que la quête de la connaissance justifie tous les maux – mais les justifie-t-elle vraiment tous ? 2) que les bénéfices possibles pour notre propre espèce justifient le mauvais traitement d’autres espèces – cela pourrait être un argument valable s’il s’appliquait à des expériences dans lesquelles les chances de souffrir étaient minimes et grande serait la probabilité d’aider la médecine appliquée, mais, dans ce cas également, ce serait du “spécisme” et, en tant que tel, ce serait un argument émotionnel égoïste plutôt qu’un raisonnement.
Si nous croyons qu’il est mal d’infliger de la souffrance à des animaux humains innocents, il n’est que logique, du point de vue phylogénétique, d’étendre notre attachement aux droits élémentaires jusqu’aux animaux non humains. N’ayez pas peur d’exprimer votre point de vue. Contactez les parlementaires, les professeurs, les éditeurs, pour leur faire part de cette question morale dont l’importance grandit. »
4. Les expérimentations douloureuses ou sans consentement éclairé sur l’espèce humaine ont malheureusement été nombreuses dans l’histoire. Le devoir de mémoire est important pour la dignité des victimes, mais aussi à visée éducative, car de tels drames peuvent se reproduire, qu’il s’agisse de l’unité 731, des essais nazis, des tests au sarin ou sur la résistance au gaz moutarde, de l’absence de soin voire de l’inoculation concernant certaines maladies sexuellement transmissibles à des fins expérimentales. La liste est malheureusement très longue.
5. Tout le monde peut dire quelque chose d’intéressant sur n’importe quel sujet, bien sûr, mais il est généralement recommandé d’être bien documenté lorsqu’on publie un travail spécialisé. Parler de libération animale alors qu’on exploite soi-même les animaux ne permet pas même de connaître le véganisme au quotidien. Du reste, proposer de libérer les animaux est très beau mais peu réaliste. Le véganisme est une consomm’action dont la projection mène à l’extinction des lignées d’élevage par assèchement de la demande. Il ne s’agit pas d’ouvrir grandes les portes des prisons. Ne nous mentons donc pas au sujet de la libération des animaux domestiqués, d’autant que l’appauvrissement de leurs génomes par reproduction dirigée a réduit drastiquement leurs chances de survie à l’état sauvage. Bien que nous souhaitions littéralement abolir toute exploitation animale, le déversement d’individus inadaptés dans des espaces naturels les livrerait à une mort probable, avant laquelle leur nombre considérable concurrencerait les lignées sauvages pour l’accès aux ressources. Il est donc important de connaître le sujet sur lequel on entend publier. À ce titre, Singer est au moins honnête sur le fait qu’il consommait des produits d’origine animale, bien qu’il y ait une certaine confusion quant à la signification du terme végétarisme (par définition, une personne qui consomme des animaux n’est pas végétarienne) :
« Les doutes qui existent concernant la capacité d’êtres comme les huîtres à ressentir la douleur sont considérables ; et dans la première édition de ce livre je suggérai que quelque part entre les crevettes et les huîtres pouvait bien être un endroit aussi valable qu’un autre pour tracer la ligne En conséquence, je continuai à manger occasionnellement les huîtres, coquilles Saint-Jacques et moules pendant quelque temps après que je fus devenu, sous tous autres rapports, végétarien. » (Peter Singer, La Libération animale, réédition 2012, Payot & Rivages, p. 323, l’édition originale de 1975 est anglophone)
Un exemple plus problématique concernant son absence de compréhension du véganisme se trouve dans ses propos concernant la vitamine B12, car ces propos peuvent mettre la santé des personnes qui sont vraiment véganes, elles, en danger :
« Il semble exister un nutriment et un seul qui soit nécessaire et qu’on ne trouve pas normalement dans les aliments végétaux, à savoir la vitamine B12. On la trouve dans les œufs et le lait, mais pas dans les aliments végétaux sous une forme qui soit facilement assimilable. On peut toutefois l’obtenir à partir d’algues comme le varech, ou de la sauce de soja quand elle est faite selon la méthode de fermentation traditionnelle japonaise, ou encore du tempeh, graines de soja fermentées consommées dans certaines régions d’Asie et que l’on trouve aujourd’hui dans les magasins diététiques des pays occidentaux. Il se peut également que la vitamine B12 soit produite par des micro-organismes dans nos propres intestins. Des études faites sur des végétaliens qui n’avaient consommé aucune source apparente de vitamine B12 depuis de nombreuses années ont trouvé chez eux un taux sanguin de cette vitamine se situant encore à l’intérieur de la fourchette normale. Cependant, pour se garantir contre toute carence, il est facile et peu onéreux de se procurer des comprimés de vitamine B12. » (Peter Singer, La Libération animale, réédition 2012, Payot & Rivages, p. 335, l’édition originale de 1975 est anglophone)
Non, les œufs sont de très mauvaises sources de vitamine B12 ! Les œufs contiennent de la vitamine B12, certes, mais ils contiennent également des éléments inhibiteurs de son absorption. Plusieurs mesures chez l’espèce humaine à la suite de l’ingestion d’œufs crus, brouillés ou frits l’ont confirmé. Une biodisponibilité de 9 % nécessiterait une consommation de 20 à 30 œufs par jour pour garantir les apports quotidiens. Non, le varech, la sauce de soja traditionnelle et le tempeh ne sont pas des sources de vitamine B12, pas plus que les intestins sains ! L’expérience de la Société végane francophone est que ce type de propos peut mener des personnes sincères directement à la carence en vitamine B12, et leurs enfants au décès (nous pesons nos mots).
6. Combinant des substances inertes puisées dans leur milieu, les plantes stockent l’énergie du soleil grâce à la photosynthèse. Ne possédant précisément pas cette faculté, les animaux dépendent de l’énergie accumulée par les plantes (ou par ceux qui consomment les plantes).
7. En dehors du créateur du mot spécisme (Richard Ryder), qui continue de publier des ouvrages tenant principalement compte de la douleur animale, les antispécistes Singer, Regan et Francione considèrent tous que le critère de la capacité à éprouver de la douleur est insuffisant à lui seul, dans la mesure où elle peut éventuellement être épargnée à l’animal par des techniques de contournement :
« lorsque les animaux mènent une vie agréable, qu’ils sont tués sans douleur, que leur mort n’est pas cause de souffrance pour d’autres animaux, et que la mort d’un animal rend possible son remplacement par un autre qui autrement n’aurait pas vécu, le fait de tuer des animaux dépourvus de conscience de soi peut ne pas être mal. » (Peter Singer, La Libération animale, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2012, p. 401-402, l’édition originale de 1975 est anglophone).
« Les individus sont les protagonistes d’une vie s’ils :
• sont capables de percevoir et de se souvenir ;
• ont des croyances, des désirs et des préférences ;
• sont capables d’agir intentionnellement afin de poursuivre leurs désirs ou leurs buts ;
• sont sentients et ont une vie émotionnelle ;
• ont une perception du futur, dont leur futur propre ;
• ont une identité psychophysique sur la durée ;
• font l’expérience d’un bien-être propre qui, d’un point de vue logique, est indépendant de leur utilité pour les autres et de l’intérêt des autres.
Ces critères constituent une condition suffisante pour accorder une valeur propre, intelligible et qui n’est pas arbitraire […]. Du strict point de vue de la justice, donc, nous sommes obligés de faire preuve d’un respect égal à l’endroit de ces individus qui ont une valeur propre égale, qu’ils soient agents ou patients moraux et, dans le dernier cas, qu’ils soient humains ou animaux. Cette chose est due à chacun. L’injustice survient lorsque nous traitons ceux qui possèdent une telle valeur d’une façon qui manque d’afficher le respect dû (par exemple, en les traitant comme si leur valeur était réductible à la seule utilité qu’ils ont pour les autres). » (Tom Regan, The Case for Animal Rights, University of California, 1983, p. 264).
« Des philosophes tels que Tom Regan et Peter Singer ont démontré de manière convaincante qu’il ne pouvait pas y avoir de justification morale à ce que Richard Ryder a appelé le spécisme, ni à la détermination de l’accès à la communauté des égaux d’après la simple appartenance aux espèces. La détermination d’autres critères que l’appartenance à une espèce pour accéder à la communauté des égaux est présentée comme un repoussoir par bien des opposants à l’attaque du spécisme, parce qu’elle serait impossible. Bien que cette position ne me convainque pas et que je croie qu’un point de vue moral cohérent induise que nous choisissions la sentience comme critère (ce qui se traduirait par l’inclusion d’un large éventail de créatures dans la communauté des égaux), je reconnais malgré tout qu’il serait difficile d’accuser une personne d’irrationalité parce qu’elle ne serait pas d’accord sur ce seul point de vue personnel. » (Gary L. Francione, « Personhood, Property and Legal Competence », dans The Great Ape Project, New York, 1993, p. 248-257).
Tout occupés à séparer les animaux des autres règnes, aucun auteur animaliste n’a évité les contorsions doloristes ou sentientistes, alors que la réduction maximale de l’impact des vies humaines sur l’ensemble des organismes de la biosphère (plantes, champignons, algues, bactéries et archées) ne peut être réalisée qu’à condition de s’abstenir de tout produit d’origine animale.
8. Les plantes sont fréquemment décrites comme n’ayant aucun intérêt à vivre par les promoteurs de l’antispécisme :
« Si un être n’est pas capable de souffrir, ni de ressentir le plaisir, il n’y a rien à prendre en compte » (Peter Singer, La Libération animale, Petite Bibliothèque Payot, 2012, Paris, p. 318, l’édition originale de 1975 est anglophone).
9. La plupart des espèces n’ont pas encore été décrites. Nous ne disposons donc que d’estimations, mais la proportion des vertébrés est toujours relativement faible comparativement à celle des invertébrés (respectivement 80 500 contre 6 755 830 d’espèces dans A. D. Chapman, Numbers of Living Species in Australia and the World, 2e édition, septembre 2009). Par ailleurs, la simple observation reste invoquée quant à l’incapacité des insectes (majeure partie des invertébrés) à éprouver la douleur :
« les insectes continuent leurs activités normales après de graves blessures. Un insecte qui marche avec un tarse écrasé (partie inférieure de la jambe) continue de l’appuyer au sol avec la même force […] une sauterelle continue de se nourrir quand une mante religieuse est en train de la dévorer. » (Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Les invertébrés souffrent-ils ?).
10. Les bactéries (et les archées) constituent le point de départ de ce nutriment pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. Elles sont présentes de manière éparse dans certains milieux naturels, mais ne concentrent pas la vitamine B12, qu’elle peuvent éventuellement produire lorsque les conditions s’y prêtent. Pour cette raison, la consommation d’eaux stagnantes ou de terre n’a jamais pu garantir les apports en vitamine B12 de notre espèce. N’ayant aucunement besoin de vitamine B12, les végétaux ne la concentrent pas davantage à partir des sols. Les systèmes digestifs de certains animaux possèdent des organes tels qu’un rumen ou un cæcum volumineux. Ces organes sont capables d’accueillir une symbiose bactérienne productrice de B12. L’espèce humaine n’est pas équipée d’un rumen. Notre cæcum est de trop petite taille pour accueillir la symbiose bactérienne productrice de vitamine B12. Nous avons hérité de ce petit cæcum, comme les orangs-outans, les gorilles et les chimpanzés, dont aucun n’est végétalien, et dont nos ancêtres communs vivaient il y a environ 15 millions d’années.
Tous les autres besoins nutritionnels de notre espèce peuvent être satisfaits par une alimentation végétale, mais l’espèce humaine a toujours eu besoin d’une source extérieure de vitamine B12. Les sources de vitamine B12 accessibles à l’état sauvage sont les petits animaux malhabiles et riches en B12, comme les escargots et limaces, les larves de termites et autres insectes, les petits crabes et les coquillages qui jonchent les rivages. L’invention de la chasse a constitué une étape culturelle significative dans l’accessibilité à la B12, parce que les animaux de plus grandes dimensions constituent des sources importantes et moins fastidieuses à collecter. Le lacto-végétarisme est devenu techniquement possible avec l’invention de l’élevage, il y a une dizaine de milliers d’années, mais il ne s’est développé que bien plus tard.
11. La fondation de la Vegan Society en 1944 n’aurait abouti à rien d’autre que quelques accidents de santé supplémentaires, si la culture de la source originelle de vitamine B12 n’avait pas rapidement été mise au point. Il y a eu des victimes à la Société végane britannique, des morts même. C’était un lancement prématuré. D’ailleurs, la définition du terme véganisme n’a été officialisée qu’en 1950, c’est-à-dire après la découverte de la vitamine B12. Des cultures ont valorisé ou tendu vers les alimentations végétales au fil des millénaires, mais sans jamais parvenir au végétalisme, qu’il s’agisse des mythes fondateurs paradisiaques de tradition judaïque, de l’âge d’or grec ou des religions hindoues et jaïnes. Vivre sans exploiter les animaux nécessitait effectivement une avancée technique.
Le 22 octobre 1947, Edward Rickes est le premier humain à avoir vu la couleur de la vitamine B12 de ses propres yeux, sous la forme d’une traînée rose le long d’une colonne de purification, au travers de laquelle passait un résidu de fermentation bactérienne. Le 12 décembre de la même année, il obtenait enfin des cristaux rouges de vitamine B12 pure (MERCK Co., Inc., Plaintiff, v. Chase Chemical Company, Arroyo Pharmaceutical Corporation, Sidney Chasman and Randolph Chasman, Defendants). Ses concurrents continuaient de chercher la molécule mystérieuse dans des extraits de foie. Il ne les a pas détrompés (lors de sa première publication scientifique de 1948), probablement pour conserver une longueur d’avance industrielle. Ses premiers brevets d’invention ont échoué, car il est impossible de revendiquer la propriété d’une molécule naturelle.
12. La notion d’espèce est relativement vague jusqu’à l’époque moderne, puis se précise au XXe siècle. Elle fait encore l’objet de propositions d’ajustements, car, en l’état, elle est encore inadaptée à la classification des procaryotes, qui adoptent des informations génétiques plus facilement que les eucaryotes.
13. Le cannibalisme peut avoir été pratiqué pour des raisons rituelles ou par nécessité, par exemple. La difficulté consiste à identifier les marques de dents sur les os comme ayant été pratiquées par des mâchoires humaines plutôt que par d’autres animaux. Cependant, la convergence des preuves comme les traces de dents identiques ayant été laissées sur des gisements d’ossements sur des sites, les marques de cuisson, l’utilisation d’outils en pierre pour désosser, puis casser les os afin d’accéder à la moelle, etc., conduisent au consensus sur l’existence du cannibalisme.
14. L’ouvrage de Renan Larue intitulé Le Végétarisme et ses ennemis (PUF, 2015) laisse croire qu’il existerait un esprit de conspiration. La Société végane francophone observe plutôt que le prosélytisme aveugle crée ses propres oppositions. L’exemple typique est celui de Lierre Keith qui, après avoir essayé le végétalisme sans appliquer les recommandations de sécurité, se serait tournée vers une consommation de produits animaux afin de recouvrer la santé. Comme elle était mal préparée et vraisemblablement en carence, il n’est pas surprenant que son ouvrage s’intitule The Vegetarian Myth (PM Press, 2009). Les industries traditionnelles qui réagissent contre les imitations de chairs animales, de saucisson, de lait et de fromages ou de mayonnaise luttent contre ce qu’elles considèrent comme de la contrefaçon, c’est vrai, mais leur but ne peut pas être de réduire la demande en substituts (simili), seulement qu’ils soient identifiables comme tels.
15. Le terme a été lancé en 2001, puis suivi d’une parution en 2010 :
« Nous ne regardons pas la consommation de viande de la même façon que le végétarisme – en tant que choix basé sur un éventail de considérations à l’endroit des animaux, de notre monde et de nous-mêmes. Au contraire, nous regardons la consommation de viande comme une évidence, comme la chose “naturelle” à faire, la façon dont les choses ont toujours été et comme elles seront toujours. Nous mangeons les animaux sans réfléchir à ce que nous faisons ni pourquoi, parce que le système de croyance sous-tendant ce comportement est invisible. Ce système de croyance invisible est ce que j’appelle le carnisme. » (traduit depuis l’anglais, voir ci-dessous)
« We don’t see meat eating as we do vegetarianism – as a choice based on a set of assumptions about animals, our world, and ourselves. Rather, we see it as a given, the “natural” thing to do, the way things have always been and the way things will always be. We eat animals without thinking about what we are doing and why because the belief system that underlies this behaviour is invisible. This invisible belief system is what I call carnism. » (Melanie Joy, Why we love dogs, eat pigs, and wear cows, an introduction to carnism, Conary Press, 2010, p. 29)
L’alimentation originelle de l’espèce humaine n’était ni végétalienne ni végétarienne, car nos besoins extrinsèques en vitamine B12 sont démontrés.
16. Les personnes qui sont devenues véganes en ayant eu accès à des actions choc pensent effectivement que cela a été l’élément déclencheur dans leur cheminement, et en déduisent que c’est la méthode qu’il faut appliquer. Pourtant, les méthodes les plus extrêmes repoussent la plupart des populations, comme l’explique une étude récente (Matthew Feinberg, Robb Willer, Chloe Kovacheff, Extreme Protest Tactics Reduce Popular Support for Social Movements, 3 février 2017). Les campagnes extrêmes empêchent le public de s’identifier, alors que les militants croient être plus percutants.